Méditations d’un vieux militant
Encore une nuit où le sommeil, tant attendu, tarde à venir et que Youssef occupe à confier ses pensées à son journal électronique qui compense sa mémoire en déclin.
1/ A propos d’Omar
La disparition de Jos, était, pour Israël – dont l’image, partout à travers le monde, était en perdition – un impératif absolu et un avertissement à tous ceux, les Juifs surtout, qui travaillaient à salir celle-ci.
Pour les services marocains, la neutralisation de Jos n’était probablement pas une mauvaise chose, et, en tout cas, sûrement pas un impératif. Même plusieurs Jos à la tête de dizaines de manifestants n’auraient pas pu empêcher l’accostage à Tanger de navires transportant du matériel militaire à destination d’Israël. Jos n’était pas l’homme à abattre, il était même de bon aloi, dans certains cercles marocains proches du pouvoir, les partisans de la normalisation, et la plupart des pays occidentaux, qu’un pays arabe collabore avec Israël. Quant à l’opinion publique locale, elle importait si peu. Des dizaines de milliers de manifestants contre la normalisation des relations avec Israël, dans les rues des grandes villes marocaines n’ont pas obtenu la fermeture durable de la représentation d’Israël à Rabat. Les « services » ont préféré aider que se trouver devant le fait accompli.
Au, fond, Omar se trouvait dans une situation semblable à celle des autorités marocaines. Elles ne pouvaient pas empêcher l’inévitable. Et face à l’inévitable on n’a pas d’autre choix que de faire avec. En admettant qu’il fût possible de refuser de collaborer avec les services israéliens, elles savaient que ceux-ci passeraient outre.
Pour Omar, quand il fut libéré, le lundi 9 aout au matin, le Mossad avait déjà accompli son forfait. Il ne pouvait plus sauver Jos. Et avec la menace du commissaire à la préfecture, il n’avait d’autre choix que d’adopter la version officielle de l’«accident». Ce qu’il fit, sans enthousiasme, et en avisa Emma. On connait la suite. 0mar, tout en étant sincèrement affecté de ce qui était arrivé à Jos n’avait d’autre choix que jouer le rôle que lui avait assigné le commissaire. À quoi, au fond, aurait-il servi de dévoiler un secret de polichinelle déjà largement révélé par l’affaire Ben Barka : la collaboration entre services israéliens et marocains.
Jos, lui-même, n’aurait pas approuvé qu’Omar se conduisît en « héros » en révélant son week-end dans les locaux de la police de Bouskoura. Ne l’avait-il pas protégé contre les dangers de l’activisme politique en lui confiant le charbon et gardé pour lui les chardons. N’eût-il pas été trahir leur alliance que de jouer les Don Quichotte ?
L’erreur probable d’Omar vis-à-vis des camarades de Jos a été de les confronter maladroitement, de sorte à ne leur laisser aucun doute sur sa supposée « trahison ». Mais Youssef, avec ses dizaines d’années de militantisme, n’a-t-il pas été victime du syndrome du jeune militant : Ne pas être avec nous, c’est être contre nous. Le principe physique de l’action et de la réaction a fait le reste : plus Youssef et ses camarades se montraient méfiants d’Omar et plus ce dernier éprouvait le besoin de les narguer.
- De la peur et du renoncement
Et pendant que Youssef était engagé sur le terrain de l’autocritique, il repensa à Hakim et à sa diatribe contre la passivité des associations, leur dérive vers la bureaucratie et le recyclage des anciens révolutionnaires dans un humanisme institutionnel, moins risqué.
Lui-même avait murmuré, dans un réflexe incontrôlé : «Ils ont peur.»
Mais peur de quoi, au juste ?
Et surtout, était-il légitime de le leur reprocher ?
La peur n’est-elle pas un réflexe humain élémentaire ?
N’est-elle pas, depuis la nuit des temps, le garant de la survie de l’humanité?
L’espèce humaine aurait-elle traversé des milliers de siècles sans l’instinct de préservation?
Youssef se posa alors une question qu’il avait longtemps évitée : Etait-il prêt à passer les années qui lui restaient à vivre derrière les murs d’une prison ?
Aurait-il consenti à ce que chaque jour ressemble au précédent, sans horizon, sans famille, sans espoir ?
Et pourtant lui aussi avait, comme Jos et d’autres anciens détenus, renoncé à beaucoup de choses : En tant qu’un des premiers lauréats d’une grande école parisienne, il pouvait prétendre à une brillante carrière dans l’administration avec villa, limousine et chauffeur. Il avait renoncé à fonder une famille et par-dessus tout, il avait renoncé à sa liberté.
Mais avait-il vraiment renoncé à TOUT ?
Lors de l’unique visite que lui rendit Malika en prison, il l’avait suppliée de ne plus venir le voir. De ne pas lui écrire même. Mais ses lettres se succédèrent. Il ne les ouvrait pas. Cependant, il les rangeait avec les lettres qu’il avait reçues de Jos et qu’il avait été autorisé à garder.
Pendant le premier mois de sa détention, il s’est abstenu d’aller au parloir où il savait que Malika se trouvait et c’était un supplice. Pire que les mauvais traitements qu’il avait subis avant de comparaitre devant un juge.
Mais quand il fut libéré, huit ans plus tard, il fut ulcéré de ne pas la voir devant le portail de la prison.
Il se promit d’en parler à ses camarades. Ne faudrait-il lever l’anathème, jeté trop vite sur les autres, pour mieux se disculper ?
La peur n’était pas une lâcheté. Elle traduit le désir humain de préserver ce qu’on a ; l’intégrité de son corps, sa famille, sa carrière, ses biens, tout ce que nous avons et que nous risquons de perdre. Jeunes militants, nous avions transcendé la peur par inconscience comme Omar, adolescent, qui a défié un monarque intransigeant, sanctifié dans la constitution, sans penser aux conséquences. Et Il a persisté devant la court. Par bravade pour épater ses coprevenus.
Mais alors, pourquoi Jos, lui, n’avait-il pas peur ?
Son renoncement aurait-il été plus total, entier, sans retour ?
Sa séparation de Danièle, sa femme, ne s’est pas faite dans le désespoir qui accompagne la soumission à un destin cruel. Mais presque froidement, lors de sa première visite, un mois après son incarcération. Il savait que cette scène aurait lieu un jour ou l’autre et il s’y était préparé. Il savait qu’il avait toujours été en liberté provisoire.
À sa manière méticuleuse, il avait mis au point les conditions, largement en faveur de Danièle, de leur divorce. Il avait rédigé, signé et fait légaliser tous les papiers nécessaires. Il lui a suffi de lui indiquer où les trouver et ils se séparèrent sans un mot. Juste un sourire attendri sur la face de Jos et un éclair furieux dans le regard de Danièle. Elle ne s’étonna, même pas, de trouver dans la grosse enveloppe qu’il lui avait laissée un billet d’avion ouvert pour Paris où elle avait de la famille. L’image de Jos au parloir surgit, un court instant dans son esprit. Elle l’écarta à jamais.
Jos n’avait plus rien à protéger. Ni famille, ni carrière, ni possessions. Même sa vie ne lui appartenait plus vraiment. Elle s’était dissoute dans les causes pour lesquelles il s’était engagé.
Il vivait sa détention, presque heureux, entre ses camarades et les livres que ses amis en liberté – Youssef pendant quatre ans et d’autres, ensuite – lui procuraient.
3/ Jos surhomme ?
Jos n’était pas un héros, Il avait simplement, par un effort surhumain, sublimé la peur. Par un travail permanent sur lui-même, il avait franchi une ligne invisible pour atteindre un niveau de détachement mystique.
Jos n’était pas un surhomme. C’étaient eux, les autres, qui avaient encore, parfois sans le savoir comme Youssef, quelque chose à préserver, et dont ils ne parvenaient pas à se détacher.
Jos, par contre, en avait conscience. En décédant, son père lui avait légué une affaire commerciale prospère. Un cadeau empoisonné. C’était le piège, irrésistible pour la plupart des humains, de l’enrichissement qui lui était tendu. Il le contourna habilement en le transformant en moyen de protéger Omar lorsqu’il décida du partage des tâches entre eux deux : A Omar la gestion de son affaire – moins risquée qu’un week-end à Marrakech où on risque, à tout moment, de se faire renverser par un deux-roues lancé a toute vitesse, à contre sens, dans une rue sans échappatoire- et à lui le militantisme bien plus dangereux.
Il avait un mépris total, voire une haine viscérale du capitalisme, de l’accumulation qui ne peut se faire que par l’exploitation des travailleurs, quelle que soit la bonté dont le capitaliste peut témoigner envers ses employés. Pour lui, le marxisme n’était plus une idéologie mais une religion.
Le jour ou Youssef réalisa qu’en tant que fonctionnaire, il collaborait à l’exécution d’une politique fondamentalement capitaliste. Que dans son travail, il était réduit à un pousse papier, que la politique agricole était élaborée ailleurs qu’au « Ministère » dont le rôle se limitait à la mise en œuvre d’une politique au service des grands propriétaires fonciers. Ce jour-là, il décida de démissionner et de s’établir à son propre compte. Il en avisa Jos dans la première des lettres qu’ils avaient pris l’habitude d’échanger quand il ne pouvait pas lui rendre visite. La réponse de Jos, ne se fit pas attendre :
« Je suis profondément étonné et déçu de ta décision. On peut être un rouage malgré soi mais on devient complice par choix. Ce qui est pire. Bien entendu, ton nouveau statut de petit patron, ne changera rien à notre amitié. Tiens-moi au courant. Et n’oublie pas les abonnements aux revues que je t’ai demandés au nom et adressé de la personne que tu connais, elle me les fera parvenir par le circuit habituel. J’ai bien reçu les livres et je t’en remercie. Affectueusement »
Quelques mois plus tard, Youssef a été arrêté et condamné et son affaire mise en liquidation judiciaire.
En sera-t-il de même pour l’affaire de Jos, à présent qu’il n’est plus ? Ou bien, Jos aurait-il envisagé sa mort subite et pris les dispositions ad hoc ? Ou bien encore, Emma, seule héritière légitime de Jos, viendrait-elle prendre possession de son affaire pour en faire don à Omar, envers qui elle avait une dette ?
4/ Une époque révolue
Youssef avait connu d’autres temps.
Des temps où la jeunesse débordait d’une ferveur révolutionnaire naïve et irrésistible.
Il se souvenait des lycées en grève, des élèves qui descendaient dans la rue sans stratégie, parfois sans même savoir exactement ce qu’ils réclamaient — sinon le refus de l’injustice.
Au début des années 80, lorsque le ministère de l’Éducation interdit le redoublement de classe les manifestations avaient éclaté dans tout le pays. Les lycéens, rejoints par les citoyens de la classe populaire marchaient en rangs disloqués, lançaient des slogans révolutionnaires et s’en prenaient aux bâtiments publics et aux banques. Les journaux d’opposition (encore existants à l’époque), avaient qualifié le mouvement « d’Emeutes de la faim ». La répression fut féroce. Des morts par centaines, jamais dénombrés, des « martyrs de la koumira (baguette de pain) » selon le ministre de l’intérieur.
Les facultés, aussi, se mettaient régulièrement en grève. Parfois des mois entiers. L’année universitaire était déclarée blanche, comme si le savoir lui-même devait payer son tribut à la dictature.
« Dignité » était le mot d’ordre de la contestation.
En France, les étudiants marocains passaient des nuits entières en débats houleux dans des « AG de l’UNEM » (Union Nationale des Etudiants Marocains) ou des AG des résidents de la Maison du Maroc » (pour ceux de Paris). Ils pinaillaient sur la formulation exacte d’une résolution (parfois sur une virgule ou un adjectif), condamnant telle ou telle décision du gouvernement ou du gestionnaire de la résidence.
Ils sortaient à l’aube, épuisés, mais convaincus d’avoir contribué, par la seule justesse d’un mot, à infléchir le cours de l’histoire du pays ou profondément amélioré leurs conditions de vie à la résidence. Les grands ténors satisfaits de leurs harangues où Marx et Lénine répondaient à Mao et Gramsci à Heidegger. Et ceux qui n’osaient pas prendre la parole de peur d’être tancés pour leur ignorance, se promettant d’aller, dès le lendemain, chez Maspero combler les lacunes béantes dans leur culture politique et leur méconnaissance des grands textes marxistes.
Évidemment cet activisme politique débridé avait un impact négatif sur l’objet même de leur présence en France : acquérir quelques bribes de savoir à mettre au service de leur pays. Heureusement, les coopérants français restés en place après l’indépendance, en attendant la relève, étaient encore là et d’autres étaient arrivés, dans le cadre des accords de coopération technique signés avec d’autres pays – Notamment d’Europe de l’Est, moins couteux et sans préjugés – abandonnant aux nouveaux lauréats des Grandes Ecoles et facultés de France, le privilège de signer les documents, à caractère technique, qu’ils élaboraient. Ceux là étaient les plus prisés. Ceux diplômés d’Espagne ou de Russie étaient casés à des échelons moins élevés.
Au fait, y’avait-il des ingénieurs formés dans les pays arabes ? Il y avait des officiers de l’armée et de la police formés dans ces pays, mais guère de techniciens. N’avaient-ils d’autres compétences à offrir ?
5/ Un changement générationnel.
Et aujourd’hui ?
Les lycéens ne descendent plus dans la rue.
Les universités ne se mettent plus en grève.
Les étudiants ne passent plus leurs nuits à débattre d’un avenir commun.
Même la colère semble s’être assagie, domestiquée, rendue compatible avec l’ordre établi.
Les partis politiques dits d’opposition et les syndicats de travailleurs ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes …
Pourquoi ?
Youssef se garda d’une réponse trop simple.
Ce n’était pas seulement la peur.
Ni seulement la répression, pourtant toujours là, plus sophistiquée, moins apparente.
C’était peut-être que le monde avait changé.
À l’époque, on croyait encore que l’histoire avançait par ruptures.
Qu’un soulèvement pouvait tout changer.
Qu’un régime pouvait tomber.
Qu’un avenir différent était imaginable.
Aujourd’hui, on avait appris que les systèmes encaissent tout. Les grèves. Les slogans. Les indignations. Et même les révolutions.
La gestion avait remplacé la résistance et la réussite individuelle l’attrait de la lutte collective.
L’avenir commun par des trajectoires personnelles à sécuriser.
Les jeunes ne sont pas moins courageux, songea Youssef. Ils sont plus lucides – ou plus résignés.
Ils ont aussi compris que le prix à payer était devenu exorbitant en comparaison des gains à espérer.
Les Printemps arabes ont tué l’espoir.
Ne reste que l’espoir d’un diplôme, d’un emploi possible sinon d’un visa pour l’Europe ou d’un départ illégal payé à prix d’or, parfois de leurs vies.
La colère et l’indignation n’ont pas disparu. Elles se sont fragmentées. Dissoute dans le foot et dans les écrans de téléphone.
Youssef eut une pensée amère :
Peut-être que notre génération avait eu le privilège de croire aux vertus de la révolution et que la suivante avait hérité du devoir de survivre.
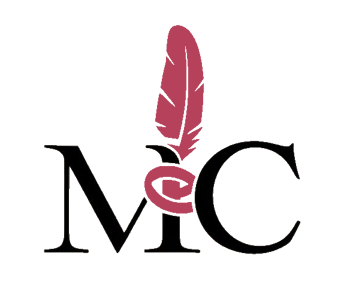
Superbe réflexion politico-existentialiste sur le changement tel qu’il est advenu bien différent du changement dont on avait rêvé. Bravo !
قب
J’ai
Lu ton blog lucide et amer. J’aime cette dissection toute scientifique, sans fioritures ni complaisance romantique. Cette allégorie , un peu désespérée ,dans laquelle notre génération se reconnaît , devrait être méditée par la génération présente. Mais je crains que le chemin soit long.
J’ai adoré te lire et j’ai hâte d’acheter le livre